Les Psychotropes
Définition
Les psychotropes sont des médicaments qui agissent sur le métabolisme du cerveau. Pour comprendre la nature de cette action, il faut savoir que notre cerveau est constitué de milliards de cellules nerveuses : les neurones.
Interagissant les unes avec les autres, elles «communiquent» entre elles. Lorsqu’une cellule nerveuse est stimulée, un courant électrique se déplace le long de son enveloppe, la membrane cellulaire. Parvenu à la terminaison de la cellule, ce courant électrique provoque la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs stimulent alors la cellule voisine en agissant sur des parties spécialisées de celle-ci. Les médicaments psychotropes agissent soit sur la concentration des neurotransmetteurs dans la fente synaptique, soit sur leur capacité à se lier aux récepteurs. Il existe un grand nombre de médiateurs chimiques. Les mieux connus sont la sérotonine, le GABA, la dopamine et la noradrénaline.
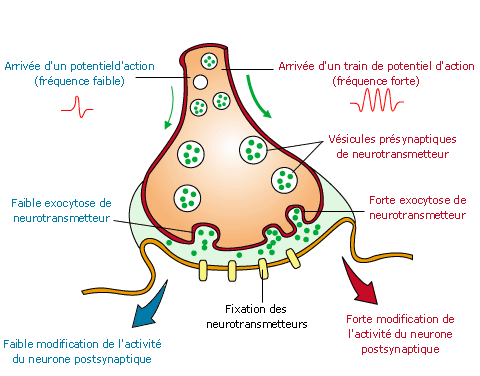

Comme on peut le voir dans le schéma n°1, le métabolisme neurologique se définit par la transmission de neurotransmetteurs entre neurones. Elle permet donc le passage de dopamine et d'autres neurotransmetteurs entre deux cellules nerveuses.
Chez la personne malade, le fonctionnement neurologique du cerveau est déréglé : il y a un surplus de neurotransmission entre les cellules ou une dégénérescence de ces neurotransmissions. Il est possible aussi que le récepteur de neurotransmetteurs soit défectueux. Alors la transmission est défectueuse elle aussi, ce qui peut amener à une dégénérescence comportementale puisque beaucoup de neurotransmetteurs sont à l'origine des humeurs comme la joie. Cette dégénérescence peut être ainsi à l'origine d'une dépression ou d'une mélancolie en cas d'absence de Dopamine qui est souvent nommée comme le neurotransmetteur de la joie.
Comme cité en amont, les médicaments psychotropes agissent soit sur la concentration des neurotransmetteurs dans la fente synaptique, soit sur leur capacité à se lier aux récepteurs. Il existe un grand nombre de médiateurs chimiques. Les mieux connus sont la sérotonine, le GABA, la dopamine et la noradrénaline. Leurs métabolismes respectifs sont influencés différemment par les différents psychotropes. Cependant le neurotransmetteur le plus particulièrement visé est la dopamine comme on peut le voir dans le schéma n°2.
Les neuroleptiques atypiques agissent principalement par antagonisme (blocage) des récepteurs dopaminergiques D2 et sérotoninergiques 5HT2A. Toutefois, cette classification est un peu simpliste : en réalité, la plupart de ces molécules agissent globalement sur l'ensemble des récepteurs aux monoamines (dopamine, sérotonine, histamine, noradrénaline). Une grande partie d'entre elles (phénothiazines, clozapine, olanzapine), ont également un effet anti cholinergique (action sur les récepteurs muscariniques), ce qui contribue à diminuer — ou tout du moins à masquer — leurs effets secondaires extrapyramidaux (ou pseudo-parkinsoniens).
On suppose que, en cas de maladie, il y a trop ou pas assez de médiateurs chimiques dans la fente synaptique, ce qui accroît ou diminue fortement la transmission de l’information entre les neurones. L’utilisation des psychotropes vise à supprimer ce déséquilibre. Comme il n’est pas possible de faire en sorte que les médicaments n’agissent que sur certaines zones de contact, ceux-ci provoquent des effets secondaires indésirables.
4 types de psychotropes :
-
Les tranquillisants ou anxiolytiques soignent les états d’anxiété. Les plus fréquemment prescrits sont des benzodiazépines et sont connus pour leur risque élevé de dépendance.
-
Les somnifères ou hypnotiques soignent certains troubles du sommeil (difficultés à s’endormir, insomnies…).
-
Les neuroleptiques ou antipsychotiques sont prescrits pour le traitement de certaines maladies mentales et ne sont pas utilisés à des fins toxicomaniaques.
-
Les antidépresseurs servent à traiter les dépressions et ont parfois des effets indésirables (perte de vigilance, somnolence, excitation…). Leur arrêt doit être progressif pour éviter des symptômes comme des nausées ou des vertiges.
Les neuroleptiques agissent sur les neurones, plus spécifiquement sur les récepteurs des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs permettent aux neurones de communiquer.
l’Haloperidol (Haldol®), la Cyamémazine (Tercian®) la Lévomépromazine (Nozinan®,) le Flupentixol (Fluanxol®), la Loxapine (Loxapac®) et le Zuclopenthixol (Clopixol®). Ces produits ont les actions suivantes :
• antihallucinatoire : ils diminuent les hallucinations auditives, visuelles, sensitives ou autres.
• antidélirante : ils atténuent ou font disparaître les idées délirantes.
• sédative : ils apaisent et diminuent l’angoisse, l’agitation ou l’agressivité, qui accompagnent les précédents symptômes.
• désinhibitrice : ils améliorent le contact du patient avec la réalité.
Deuxième génération : les neuroleptiques que l’on appelle aussi « antipsychotiques » ou « neuroleptiques atypiques » sont la Clozapine (Leponex®), l’Amisulpride (Solian®), la Rispéridone (Risperdal®), l’Olanzapine (Zyprexa®), l’Aripiprazole (Abilify®), la Quétiapine (Xeroquel®), le Xeplion® palmitate de palipéridone et l’Asenapine (Sycrest®).
La Chlorpromazine ou la molécule mère
Cl
N
N
S
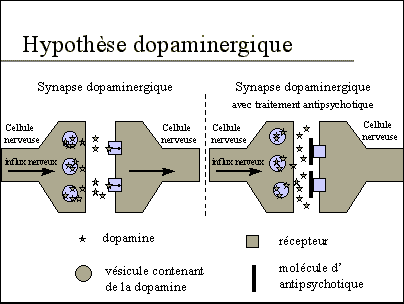
2-chloro-10-[3(-diméthylamino) propyl] phénothiazine
La Chlorpromazine est une molécule de la famille des phénothiazines. Elle se compose d'une molécule de phénothiazine où va s'ajouter un composé de chloro benzaldéhyde, d'un composé organique de diméthylamine et d'un groupement propyl.
Ce composant chimique agit sur la quantité de dopamine transmise pendant la synapse neuroléptique : on est en présence d'une action à propriété antidopaminergique.
On se retrouve donc avec une régulation du neurotransmetteur dopamine et permet de calmer les émotions du patient. Le cerveau est donc tranquilisé car les actifs neuroleptiques diminuent. (cf schéma à droite)
La chlorpromazine a quelques effets secondaires (syndrome extrapyramidal, dyskinésies, hyperprolactinémines), nets mais modérés.La molécule possède également des propriétés antihistaminiques (à l'origine d'une sédation, en général recherchée en clinique), adrénolytiques et anticholinergiques marquées .
